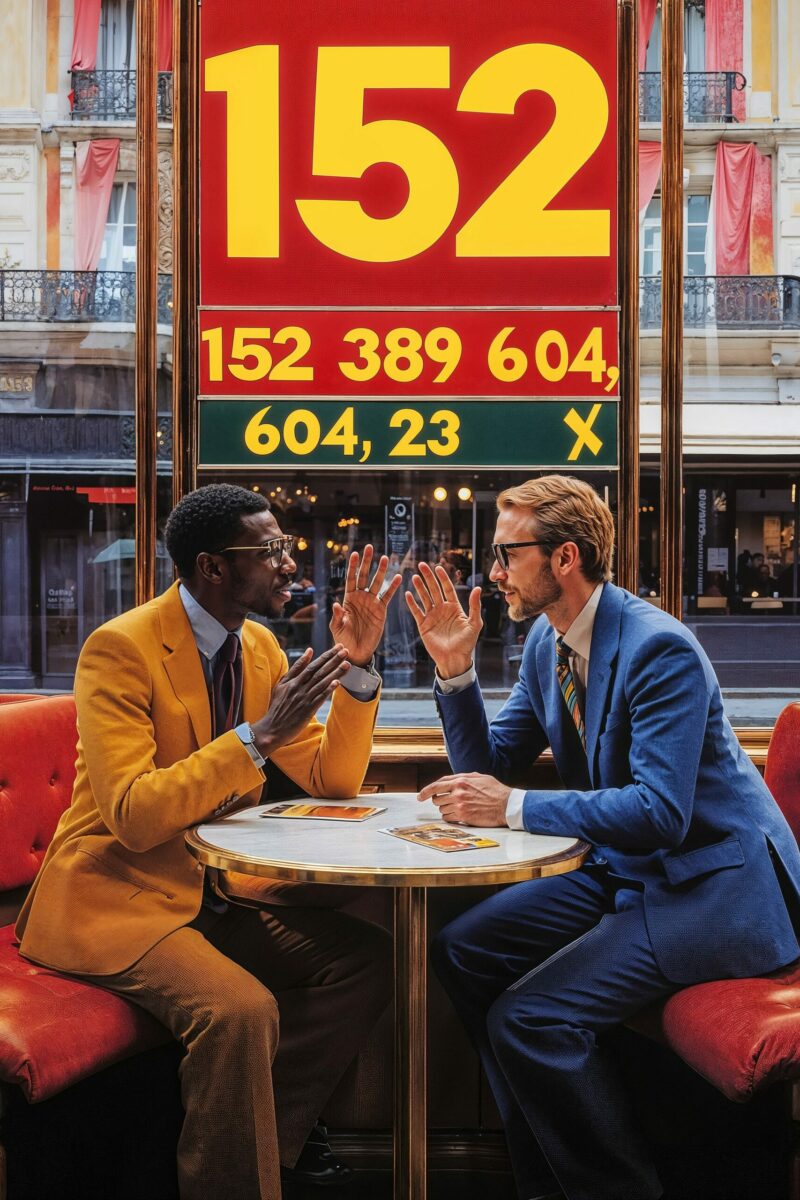Et si la preuve la plus sidérante des progrès du monde moderne se cachait dans ce que nous préférons oublier ? Les excréments. Jadis, nos ancêtres pataugeaient dans un cloaque de déjections humaines et animales, les manipulaient à mains nues, en inhalaient les relents putrides comme une fatalité quotidienne. Faute d’alternative, ces immondices servaient d’engrais pour les champs. Heureusement, nous les avons aujourd’hui presque annihilés de notre horizon quotidien.
Cette révolution silencieuse – notre émancipation triomphale de la dictature fécale – repose sur des conquêtes formidables des 2 derniers siècles : égouts modernes, engrais azotés de synthèse, moteurs thermiques et révélations de la théorie des germes. Une transformation radicale mais rarement célébrée de la condition humaine.
Avant l’automobile, les chevaux faisaient des rues urbaines des véritables cloaques. Richard Rhodes révèle dans Energy: A Human History qu’à New York, les équidés déposaient chaque jour 1,8 million de kilos de bouse et 378 000 litres d’urine en pleine voie publique ! Dans The Rise and Fall of American Growth, Robert Gordon cite ce passage édifiant de The Horse in the City :
« L’odeur des tas de fumier et les nuées de mouches qu’ils attiraient étaient parmi les nuisances les plus désagréables créées par les écuries. La nuisance était particulièrement grave en été… Sur Liberty Street à New York, il y avait un tas de fumier de 2 mètres de haut. Les rues de New York… étaient souvent recouvertes de couches de crottin. »
Ramasser la merde constituait un métier à temps plein. Comble de l’ironie : l’une des principales fonctions des chevaux était de tirer les charrettes destinées à évacuer… leurs propres déjections. Mais ne croyez pas que ces excréments étaient simplement des déchets à éliminer. Ce serait méconnaître leur valeur inestimable ! La merde était précieuse. Un trésor. De l’or brun.
La guerre du « terreau de minuit »
J’approfondisDans le Japon de l’ère Tokugawa (1603 à 1868), les excréments humains n’étaient pas considérés comme de simples déchets, mais comme une ressource précieuse au cœur d’un véritable système économique.
En 1724, un conflit éclata entre villages japonais autour d’Osaka – non pas pour éviter la corvée d’élimination des déchets, mais pour s’en disputer les droits de collecte. Cette situation s’explique par la valeur considérable attribuée aux matières fécales comme fertilisant agricole.
Au début du régime Tokugawa, les agriculteurs approvisionnaient Osaka en produits frais et recevaient en échange le « terreau de minuit » urbain. Mais l’augmentation progressive des prix des engrais transforma ces déchets en marchandise convoitée, donnant naissance à des organisations spécialisées détenant les droits exclusifs de collecte dans différents quartiers.
Cette économie des excréments était strictement réglementée : les propriétaires détenaient les droits sur les déjections solides de leurs locataires, tandis que l’urine, jugée moins précieuse, restait propriété des occupants. La valeur marchande était stupéfiante – les matières fécales annuelles de 10 foyers équivalaient à environ un demi-ryō d’or, somme permettant de nourrir une personne pendant une année entière.
L’enjeu économique était tel que des conflits éclataient régulièrement entre collecteurs rivaux. Les agriculteurs démunis, incapables d’acheter cet engrais vital, se risquaient parfois au vol d’excréments – un crime officiellement reconnu et puni d’emprisonnement par la justice japonaise.
Elle servait d’engrais !
Pendant des millénaires, le fumier, principalement issu du bétail, a été le principal moyen de régénérer la fertilité des sols après chaque récolte. Les systèmes agricoles étaient largement conditionnés par la quantité d’excréments qu’ils pouvaient efficacement utiliser. Le passage de l’agriculture sur brûlis à la rotation biennale dans l’Antiquité reposait sur le bétail qui paissait dans les pâturages avant d’être parqué la nuit dans les champs en jachère pour les fertiliser naturellement. La transition vers la rotation triennale dépendait de la charrue qui, entre autres avantages, permettait d’enfouir le fumier dans le sol, et des chariots qui facilitaient le transport de plus grandes quantités d’excréments.
Les déjections servaient également de combustible dans les régions manquant de bois, et même de matériaux de construction. Dans les zones les plus pauvres du monde, on les brûle encore aujourd’hui pour se chauffer, contribuant à une pollution intérieure dévastatrice pour la santé humaine.
La prospérité et le développement est corrélé à l’usage de sources d’énergies plus propres, plus efficaces et plus pratique pour la cuisine. Source : Our World in Data.
Au 19ème siècle, le commerce du fumier prit une dimension mondiale. Les Îles Chincha, au large du Pérou, où la pluie se faisait rare, accumulaient des fientes d’oiseaux marins depuis des millénaires. Ces montagnes de guano, hautes comme des immeubles, étaient exploitées telles des mines de charbon et exportées massivement vers l’Europe et les États-Unis.
La frénésie pour cet or brun était telle que les îles atteignirent rapidement leur « Pic de la Fiente » – épuisant totalement ces réserves millénaires en à peine 40 ans. L’obsession pour les fertilisants était si intense que plusieurs intellectuels du 19ème siècle critiquèrent vivement les égouts urbains pour leur incapacité à capturer les déjections humaines à des fins agricoles. Sir William Crookes, dans un discours de 1898, célébra « le trésor enfermé dans les eaux usées et les égouts de nos villes » (!), déplora le « gaspillage indicible » consistant à « retourner imprudemment à la mer ce que nous avons pris de la terre, » et imagina « de convertir les eaux usées en maïs. »
Dans Les Misérables, Hugo s’indigne lors de sa digression sur les égouts parisiens : « Employer la ville à fumer la plaine, ce serait une réussite certaine. Si notre or est fumier, en revanche, notre fumier est or. (…) Un égout est un malentendu. »
L’enfer des night soil men
J’approfondis
Imaginez un instant devoir plonger dans les excréments de vos contemporains chaque nuit pour gagner votre vie. C’est la réalité des « night soil men » ou « gong farmers » de l’Angleterre victorienne, ces vidangeurs de fosses d’aisance dont l’existence révèle une face méconnue et nauséabonde de notre passé.
Ces travailleurs de l’ombre opéraient généralement en équipes de 4 : un malheureux descendait dans la fosse pour pelleter les matières, un second remontait les seaux à l’aide d’une corde, tandis que deux autres se chargeaient de vider le contenu dans des tonneaux. Une chorégraphie nocturne orchestrée autour de l’excrément humain.
Paradoxalement, ce métier repoussant offrait une rémunération attractive – environ 23 shillings par semaine, soit près du double du salaire d’un majordome ! Cette générosité s’expliquait aisément : qui accepterait volontiers de patauger dans les déjections humaines sans compensation suffisante ?
Malgré cette reconnaissance financière, ces hommes subissaient un ostracisme social absolu. On les évitait comme la peste, on se plaignait de leur odeur pestilentielle. Et pour couronner le tout, ils découvraient régulièrement dans les fosses bien plus que des excréments : cadavres d’animaux, corps de nourrissons non désirés, voire restes de victimes de meurtres…
Mais le véritable danger résidait dans l’invisible : le sulfure d’hydrogène, gaz mortel issu de la fermentation des déjections. Ce « coup de plomb » provoquait des symptômes terrifiants : sensation d’écrasement thoracique, convulsions, cris involontaires (que les vidangeurs appelaient tragiquement « chanter le plomb »), délire, rire sardonique, puis asphyxie parfois fatale.
Ce métier a disparu grâce aux formidables innovations de notre civilisation techno-industrielle. On ne le regrettera pas.
Rassurez-vous, tous les déchets urbains n’étaient pas perdus ! Les déjections équines étaient acheminés vers les campagnes, tout comme certains déchets humains, pudiquement baptisés « terreau de minuit » (« night soil »). On imagine aisément que la collecte de cette matière devait être une tâche particulièrement répugnante. Le terreau de minuit demeure encore aujourd’hui une ressource exploitée dans les pays les plus démunis.
Comment l’humanité s’est-elle affranchie de cette condition insalubre qui fut jadis son quotidien ? Rendons d’abord hommage à l’avènement des égouts modernes. En 1833, Paris inaugura son premier réseau d’égouts destiné à canaliser tant les eaux pluviales que celles issues du lavage des voies publiques. Quelques innovations déterminantes marquèrent ensuite l’aube du XXe siècle : l’engrais azoté de synthèse, nous libérant ainsi de notre ancestrale dépendance au fumier ; puis l’essor des transports mécanisés — d’abord les tramways électriques, suivis des automobiles — mettant un terme à ce que Gordon qualifiait avec justesse de « tyrannie du cheval ».
L’adoption fulgurante de ces technologies a été catalysée par la nouvelle théorie des germes et la prise de conscience scientifique que les matières fécales constituaient des véritables bombes bactériologiques.
L’invisibilité des excréments dans notre quotidien n’est pas l’état naturel de la condition humaine, mais bien l’une des plus remarquables conquêtes de notre civilisation moderne.
Cette révolution silencieuse, que nous tenons aujourd’hui pour acquise, représente une rupture fondamentale avec des millénaires d’histoire où l’humanité vivait littéralement entourée de déjections. Ce changement radical dans notre rapport à la merde constitue peut-être l’un des progrès les plus tangibles – quoique trop rarement célébré – de notre modernité technologique et sanitaire.