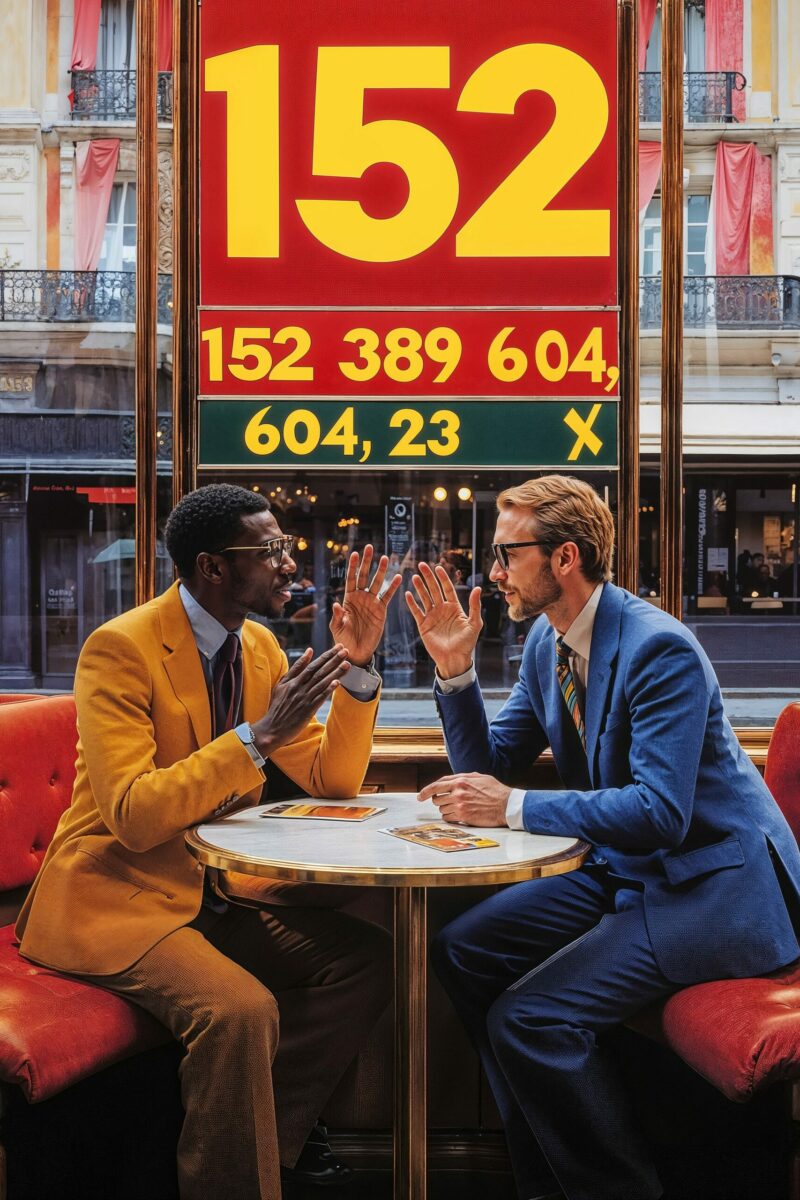Les mégabassines ? Symboles de la guerre de l’eau ! D’un côté des agriculteurs culpabilisés. De l’autre des activistes d’une écologie fantasmée et des politiques avides de récupération. Entre eux des monceaux de désinformation. Un subtil débat à trancher.
Le mot « mégabassine » s’est hissé au sommet de l’actualité en mars 2023, dans un déferlement de violence et de gaz lacrymogènes. A Sainte-Soline. Jusque-là, paisible commune des Deux-Sèvres, où l’un de ces réservoirs est devenu le totem des antagonismes liés à l’usage de l’eau dans l’agriculture. Un sujet majeur. Car cette ressource, envisagée inépuisable et pourtant précieuse, s’affirme comme un enjeu brûlant à l’heure du changement climatique. Entre les agriculteurs irrigants qui clament la nécessité de ces retenues hydriques et leurs opposants qui en dénoncent l’inutilité, en plus d’y voir les symboles des tares supposées du capitalisme, qui a raison ? Comme souvent, la question, aussi schématiquement posée, offre le meilleur moyen de passer à côté du sujet et de le renvoyer dans les cordes d’un manichéisme juste bon pour les joutes en réseau. Alors oublions le buzz et passons à l’éclairage.
Les mégabassines, c’est quoi exactement ?
Il s’agit de gigantesques cuvettes artificielles recouvertes de bâches plastiques et remplies en hiver par pompage depuis des rivières ou des nappes phréatiques. L’objectif ? Réserver d’importants volumes d’eau pour irriguer les cultures en été, quand la pluie se fait rare. Ça se tient.
D’autres solutions existent, comme les retenues collinaires (petits lacs artificiels remplis par ruissellement), les barrages et certains dispositifs qui favorisent l’infiltration de l’eau dans les nappes souterraines. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Les barrages offrent d’importantes quantités de stockages, mais peuvent perturber le cours des rivières, tandis que les retenues collinaires s’intègrent mieux dans le paysage mais nécessitent une topographie adaptée au ruissellement.
Un débat sous tension
Si les agriculteurs voient dans ces infrastructures un moyen de sécuriser leur production, d’autres dénoncent un accaparement de la ressource au profit des plus nantis, un impact sur la biodiversité et la tentation de surconsommer l’eau au détriment de pratiques plus vertueuses. Or, dans tous les projets actuels, donc, celui de Sainte Soline, ce dernier sujet est au cœur du cahier des charges imposé aux agriculteurs, amenés à s’engager dans une démarche de transition agroécologique plus parcimonieuse dans l’usage de l’eau. Quant à l’idée, profitable politiquement pour certains, d’une manœuvre des exploitants les plus riches, elle est battue en brèche par le profil des agriculteurs de la zone, similaire à la moyenne régionale.
Les scientifiques, eux, sont partagés. Le GIEC estime par exemple que ces réservoirs « coûteux, ont des impacts environnementaux et ne seront pas suffisants partout en cas de réchauffement trop important ». Il les inclut néanmoins parmi les « solutions efficaces d’adaptation ». Des études locales montrent surtout, et c’est là l’angle mort des polémiques, que leur efficacité dépend du contexte géologique. En résumé, selon leur terrain d’élection, toutes les mégabassines ne se valent pas.
Car, c’est ballot, elles n’ont pas la même utilité selon les roches qui enserrent les nappes, appelées aquifères. Quand elles sont poreuses, l’eau circule et s’infiltre lentement. Quand elles présentent des fissures, l’écoulement est bien plus rapide. On parle alors de nappes réactives dont le contenu rejoint (trop) rapidement l’océan. Et, on vous le donne en mille… c’est le cas à Sainte-Soline, au sous-sol très perméable, comme le confirme une étude du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), dont les conclusions sont sans appel. Non seulement le stockage permettrait une augmentation des niveaux des nappes et du débit des cours d’eau locaux pendant l’été, mais son impact serait limité en hiver. Il devient alors pertinent d’y capter l’eau à cette saison, avant qu’elle ne se fasse la malle ! Mais au profit de qui ?
Privatisation de l’eau et évaporation, vraiment ?
L’argument massue des opposants à Sainte-Soline ? La prétendue « privatisation » de l’eau par certains agriculteurs. Pourtant, les prélèvements se font exclusivement en hiver, quand la ressource est abondante pour tous et ne se répercute pas sur le remplissage estival. Or, nul pompage n’étant effectué pendant l’été grâce à nos mégabassines, celles-ci pourraient même soulager les nappes phréatiques en période critique. Le doute peut néanmoins survenir en cas de « sécheresse hivernale ». Car si les deux mots semblent former un oxymore, ces périodes arrivent ponctuellement.
Autre idée reçue… et fausse : l’évaporation massive du contenu de nos réservoirs. Certains chiffres alarmants circulent, évoquant jusqu’à 60 % d’eau perdue ! Une fake news rapportée par un hydrobiologiste émérite du CNRS, Christian Amblard, qui l’a offerte en pâture à la presse qui s’est empressée de la reprendre sans la vérifier. Sauf que ce chiffre provient d’une étude sans rapport avec les mégabassines ! Celles menées à ce sujet montrent que l’évaporation ne dépasse pas 5 % !
Une solution… parmi d’autres

La réalité étant toujours plus complexe que l’idéologie, le rejet total comme l’adoption aveugle de telle ou telle dispositif est absurde. A l’inverse d’une évaluation de chaque projet au cas par cas, dans un contexte de réel changement climatique qui, à terme, pourrait contraindre la possibilité de remplir nos fameuses bassines, en plus d’affecter la biodiversité.
Or, face à ce défi et à la raréfaction d’une ressource aussi vitale que l’eau, une seule chose est sûre : il faudra diversifier nos stratégies et s’adapter avec intelligence. Les mégabassines sont, comme à Sainte Soline, un outil parfois pertinent, mais elles ne doivent pas brider l’imagination face à des contextes divers, encore moins devenir une variable d’ajustement de combats sans fondements scientifiques. A plus forte raison que ces derniers ne se contentent pas d’une idéologie sans prise avec le réel mais s’accompagnent d’une violence aux lourdes conséquences. Une violence et une hystérisation du débat portée par certains activistes risquant de conduire les agriculteurs au renoncement. Mais aussi de les jeter dans les bras de syndicats proches de l’extrême droite, comme on l’a constaté lors des récentes élections aux chambres d’agriculture.